Une concertation sociale détricotée peut-elle aboutir à un accord interprofessionnel ?
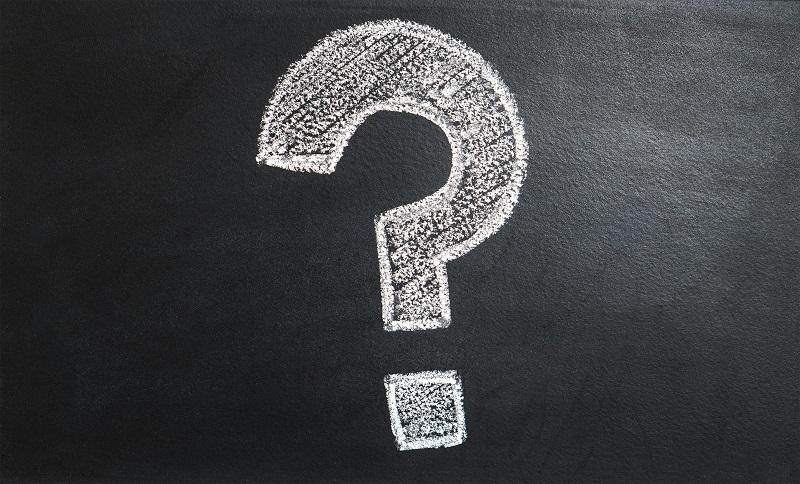
Publié le
Il y a suffisamment de thèmes pour conclure un accord interprofessionnel fort pour 2025-2026. L’essence même d’un tel accord, une marge salariale digne de ce nom, a toutefois été enlevée de la concertation par l’intervention du gouvernement.
La concertation sociale est un fondement de tout Etat-providence. Dans le cadre de cette concertation, syndicats et employeurs concluent des accords de façon autonomes sur des thèmes qui les concernent : salaires et conditions de travail, sécurité sociale, marché du travail etc. Cette autonomie est ancrée dans les traités internationaux. Pensons par exemple à la convention 98 de l’OIT sur le « droit d’organisation et de négociation collective » ou encore, à la Charte sociale européenne.
Concertation sociale autonome
En Belgique, de façon générale, la concertation sociale a toujours été respectée. Les gouvernements approuvaient la plupart du temps les accords conclus entre interlocuteurs sociaux. Ce faisant, les oppositions au sein du gouvernement étaient dépassées et la paix sociale, garantie : les accords avaient en effet parcouru tout un processus démocratique dans les syndicats.
Ces dernières années, ce système de concertation sociale autonome a été fortement mis sous pression. Le point de basculement a été la crise financière de 2008. Sous la pression des marchés financiers et de la surveillance économique mise en place par l’Union européenne, les gouvernements ont appliqué des réformes fondées sur la pensée néolibérale. La concertation sociale, et certainement les syndicats, freinent de telles réformes, avec les conséquences que l’on devine : les règles de la concertation sociale sont devenues plus strictes et la marge de manœuvre s’est réduite. Et ce, en raison de l’intervention directe de l’Etat. Il n’y a désormais plus deux, mais trois parties à la table des négociations, le gouvernement jouant un rôle décisif.
Marge zéro
Prenons l’exemple des négociations salariales interprofessionnelles. L’accord interprofessionnel (AIP) conclu tous les deux ans a pour essence même la fixation d’une marge salariale. Cette marge donne une indication pour conclure des accords salariaux dans les secteurs. Depuis la réforme de la loi salariale de 2017, il est devenu impossible de conclure une accord salarial parce que les paramètres adaptés de la loi salariale sont de plus en plus souvent réduits à zéro. Le gouvernement impose ainsi unilatéralement une modération salariale.
En 2025, l’intervention de l’Etat dans la formation des salaires est à nouveau décisive. En février, le Conseil central de l’économie publiait son rapport technique, contenant la marge salariale. Pour la deuxième fois consécutive, cette marge est nulle. Avec l’ancienne loi, la marge salariale aurait été proche du pour cent. Rien de très impressionnant, certes, mais cette loi – ancienne mouture – laissait la liberté aux secteurs de déroger à la norme, en fonction de leur niveau de productivité et de leurs chiffres bénéficiaires. Les interlocuteurs sociaux étaient suffisamment sages et expérimentés que pour déterminer ce qui était nécessaire pour garantir la compétitivité de leur secteur.
Intervention du gouvernement
Aujourd’hui, l’intervention du gouvernement ne se limite plus à la seule marge salariale. Le gouvernement De Wever a décidé – sans aucune concertation – d’augmenter les chèques-repas et le salaire minimum. Si cela semble positif au premier abord, le fait que de telles mesures touchent au fondement même de la concertation sociale et le fait qu’elles nécessitent donc des CCT, semble totalement échapper au gouvernement. Sur le plan des réformes du marché du travail, même constat : les flexi-jobs sont ouverts à tous les secteurs. La suppression brutale de la prépension (RCC) du jour au lendemain est un autre exemple. Que de telles mesures aient un impact fondamental sur les travailleurs et nécessitent donc une concertation, ne semble pas inquiéter le gouvernement.
La concertation sociale est ainsi réduite à un simple « buffer » qui doit modérer fortement la politique gouvernementale. C’est dans ce contexte que cadre le mini-accord conclu au Groupe des 10 sur le report de la fin des RCC et le renforcement des emplois de fin de carrière : sans l’intervention des interlocuteur sociaux, des milliers de personnes seraient restées sur la touche en raison de la politique irréfléchie du gouvernement.
Tous ces éléments constituent le préalable des négociations interprofessionnelles qui débutent aujourd’hui. Il y a suffisamment de thèmes sur la table. En 2025, l’inflation s’avère nettement inférieure à ce qui avait été prévu. Le moment n’est-il dès lors pas venu de procéder à un nouveau calcul de la marge salariale, comme le CCE l’a également fait en 2019 ? Comment renforcer le pouvoir d’achat des travailleur en période d’incertitude ? Prenons l’exemple des chèques-repas : comment veiller à ce que la décision du gouvernement de les augmenter profite à un maximum de travailleurs ? Quelle trajectoire de croissance définir pour le salaire minimum ? Un accord de 2021 fait le lien entre les salaires minimums en Belgique et en Allemagne. Le salaire minimum allemand passera à 15 euros en 2026.
Et ne serait-il pas temps d’élargir les maigres congés légaux de vingt jours ? Parmi les autres thèmes qui doivent être discutés, nous pouvons citer la flexibilité imposée par le gouvernement et le débat sur les fins de carrière. Sans oublier la mobilité, sujet autour duquel il y a aussi beaucoup à convenir.
Il y a donc suffisamment de thèmes pour conclure un accord interprofessionnel fort avec du contenu. L’essence même d’un tel accord, une marge salariale digne de ce nom, a toutefois été enlevée de la concertation interprofessionnelle par l’intervention du gouvernement.
Mécanismes de contrôle
Qualifier de telles interventions de « déplacées » serait un euphémisme. Ce n’est ni plus ni moins qu’une violation du droit international. En 2022, suites à l’introduction d’une plainte par les syndicats belges, la position de l’OIT avait été sans équivoque : en Belgique, la liberté de négocier des salaires de façon autonome est fortement limitée pour les interlocuteur sociaux, la loi salariale est incompatible avec la convention 98 de l’OIT. Cette dernière a recommandé à notre gouvernement de réformer la loi salariale et aux interlocuteurs sociaux, de fixer les critères qui déterminent les salaires.
Le gouvernement De Wever a en tout cas décidé de passer outre cette recommandation de l’OIT dans son Accord de coalition et de maintenir la loi salariale dans sa forme actuelle. Il demande aux interlocuteurs sociaux un avis sur la loi salariale. Toutefois, avec un gouvernement qui joue résolument la carte de la modération salariale et un dédain sans pareille pour la concertation sociale, on peut craindre qu’un tel avis fasse rapidement l’objet d’un classement vertical.
Ce gouvernement ne peut pas oublier que la concertation interprofessionnelle a son rôle à jouer. Les institutions n’ont pas été touchées, les organisations dans cette concertation ont une base solide et une forte représentativité. A l’heure où l’on voit tout l’impact que peut avoir la réduction des mécanismes de contrôle sur la démocratie, la concertation sociale doit être respectée et renforcée. Et en ce sens, la première étape est un accord interprofessionnel fort avec du contenu.
Auteur : lars.vandekeybus@fgtb.be